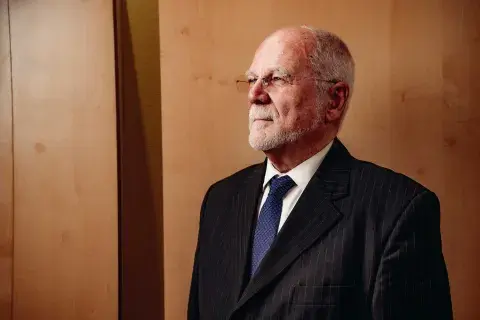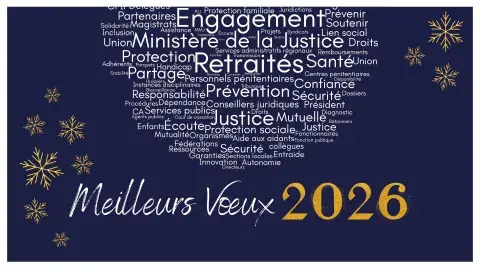Reportage terrain : entretien avec Agnès, surveillante pénitentiaire retraitée
À 22 ans, Agnès franchissait les portes de Fleury-Mérogis comme surveillante pénitentiaire. Aujourd'hui retraitée, elle revient sur son parcours qui témoigne du courage quotidien d'une femme qui a su concilier métier exigeant et vie de famille.

"Dans la pénitentiaire, on ne travaille jamais seul."
Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
Je suis originaire du Loir-et-Cher. Après le bac, j’ai commencé une fac d’anglais, puis de droit, mais rien ne me convenait vraiment. J’ai décidé de passer des concours de la fonction publique. L’administration pénitentiaire m’a répondu en premier, alors je me suis lancée. Je suis entrée en octobre 1989 à l’ENAP, puis j’ai fait mon stage à l’hôpital de Fresnes. Ensuite, j’ai été affectée à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, où je suis restée dix ans.
C’est un grand établissement, travailler là-bas a été très formateur. C’est aussi à Fleury que j’ai rencontré mon mari, qui travaillait dans le centre pour jeunes détenus. En 1999, nous avons chacun demandé une mutation pour le centre de détention de Mauzac.
Nous avions découvert la région en vacances et nous avions envie de nous y installer. Il y avait justement un poste féminin ouvert, j’ai eu de la chance ; j’ai eu le poste et mon mari m’a suivi. Nous y avons élevé nos trois enfants : une fille et deux garçons jumeaux. J’ai terminé ma carrière à Mauzac et je suis partie à la retraite en août 2022. Aujourd’hui, mon mari travaille encore, et moi, je reste en contact avec le milieu en allant parfois déjeuner avec lui au mess du personnel*.
* Le mess est la cantine des agents de la pénitentiaire.
Comment avez-vous vécu vos débuts dans la pénitentiaire ?
À 22 ans, j’étais assez timide et réservée. Et il faut bien le dire, à Fleury, je n’étais pas en présence d’enfants de chœur. Mais cette expérience m’a forgé le caractère : j’ai appris à gérer des situations très dures, comme des suicides, des bagarres, des détenus en grande détresse. Ce sont des expériences qui marquent à vie et qui sont très formatrices.

Quel est le souvenir le plus marquant de votre carrière ?
Le souvenir le plus marquant, c’est sans doute mon passage à la nurserie de Fleury. Voir des bébés partir alors que leur maman restait en détention, c’était très dur. Ces séparations m’ont profondément marquée. J’ai aussi rencontré des femmes très jeunes en grande détresse, certaines connaissaient tout du système et s’arrangeaient pour être incarcérées pour passer l’hiver au chaud.
On en apprenait parfois la mort quelques années plus tard dans la plus grande misère. Ce sont des histoires qui rappellent que, même en détention, on ne peut pas rester insensible à la souffrance.
Être une femme dans un milieu très masculin, comment cela s'est-il passé ?
À Fleury, il y avait déjà une bonne solidarité entre collègues, femmes et hommes. Mais quand je suis arrivée à Mauzac, nous n’étions que quatre femmes. Là, il a fallu trouver ma place. On m’a d’abord affectée à la porte. Peu à peu, j’ai pu occuper des postes en détention, comme celui qu’on appelle le « rond-point » : un lieu central où les détenus venaient demander des papiers, téléphoner, poser des questions. Ma hiérarchie s’est rendu compte que certains conflits étaient plus faciles à régler avec une femme en poste, par le dialogue, et on m’a gardée pour travailler en détention.
Cela n’empêchait pas la difficulté d’articuler vie professionnelle et vie de famille. Avec trois enfants en bas âge, il fallait trouver des solutions. Avec mon mari, nous travaillions dans deux équipes différentes pour gérer les horaires et garder les enfants. Nous nous sommes beaucoup soutenus mutuellement.
Quelles valeurs vous ont guidée tout au long de ces années ?
La solidarité, sans hésiter. Dans la pénitentiaire, on ne travaille jamais seul. L’équipe, c’est comme une deuxième famille. La stabilité aussi. Grâce à la sécurité de l’emploi, j’ai pu construire ma vie, acheter une belle maison et donner à mes enfants la chance de faire des études supérieures. Pour ça, je suis très reconnaissante d’avoir pu faire ce métier.
Enfin, la persévérance. C’est un métier très usant : les nuits, les horaires décalés, la fatigue psychologique et physique… J’ai tenu jusqu’à 55 ans l’âge de mon départ à la retraite. Mais je savais qu’il fallait durer pour assurer la sécurité et l’avenir de ma famille.
Comment avez-vous vécu votre départ à la retraite ?
Au début, ça a été un choc. On perd 80 % de son lien social du jour au lendemain. Ce travail prend tellement de place dans une vie qu’il faut se réinventer.
Aujourd’hui, je fais beaucoup de sport : du Pilates, de la marche. Je fais aussi du bénévolat dans une maison de retraite. Et je continue à voir mes anciens collègues, ce qui m’aide à garder le contact avec ma vie d’avant.
La retraite est un changement qu’il faut anticiper. Je riais concernant les stages de préparation à la retraite, mais c’est très utile.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui entre aujourd'hui dans l'administration pénitentiaire ?
D’abord, je lui dirais de viser les évolutions. Moi, je suis restée surveillante toute ma carrière, mais aujourd’hui, il existe plein de possibilités : ERIS, PREJ, ou d’autres spécialisations. Il faut se donner les moyens de progresser. Ensuite, de savoir couper. Le soir, une fois qu’on a rendu les clés, il faut rentrer chez soi et penser à autre chose. C’est indispensable pour tenir dans ce métier, qui est difficile à la fois physiquement et psychologiquement.
Comment voyez-vous l'évolution de votre métier ?
Je trouve que c’est devenu très compliqué. De moins en moins de jeunes veulent entrer dans la pénitentiaire. La fonction publique n’attire plus. Ceux qui passent le concours le font souvent pour aller ailleurs ensuite. Et puis l’autorité des surveillants n’est plus la même. Au début de ma carrière, il y avait un vrai respect. Aujourd’hui, on doit constamment se justifier, y compris sur des événements qui ne devraient pas relever de notre responsabilité. C’est usant.
Enfin, que vous inspire le mot "juste" ?
Pour moi, "être juste", c'est une question d'équilibre et de respect. C'est pouvoir prouver que quelqu'un est coupable avant de le condamner.
Mais j'ai le sentiment que la justice se perd, et ça se ressent aussi en prison. Les surveillants doivent se justifier de tout, et cela contribue à la dégradation des conditions de travail.