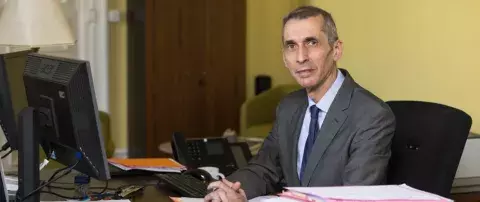Reportage terrain avec Dominique Voglimacci, président d ela cour d'assises et de la cour criminelle de Basse-Terre, en Guadeloupe
Après 42 ans d'exercice au service de la justice, Dominique Voglimacci, actuellement président de la cour d'assises et de la cour criminelle de Basse-Terre en Guadeloupe, s'apprête à prendre sa retraite.
Direct, cet homme, dont les origines montpelliéraines se retrouvent dans une pointe d'accent chantant, partage son expérience. Il en ressort une ligne directrice : énergie !

"Ce qui est juste, ce n'est pas l'application aveugle de la loi, c'est la recherche d'un équilibre"
Que vous inspire le mot "juste" ?
Le mot juste, pour moi, ce n’est pas simplement l’application mécanique de la loi. Ce qui est légal n’est pas toujours juste.
Être juste, c’est chercher l’équilibre, concilier les intérêts en présence. Une décision de justice ne satisfait jamais tout le monde, mais notre rôle, c’est de viser un point d’équilibre entre la douleur des victimes, la possibilité de réinsertion de l’accusé, les exigences du parquet. J’imagine que cela doit être vertigineux pour un juré, mais c’est cette complexité humaine qui fait la richesse et la difficulté de notre métier.
Je n’ai pas tout planifié. J’ai choisi le pénal dès le départ, mais ensuite, j’ai saisi des opportunités et avec le temps, mon parcours est devenu extrêmement cohérent.

Pouvez-vous nous décrire votre attachement à votre métier en quelques mots ?
C’est un métier qui permet une grande diversité de fonctions et de cadres de travail : en métropole, en Outre-mer ou à l’international. Ce n’est pas un métier figé. La possibilité de changer tous les 3 ou 4 ans évite la routine et renouvelle sans cesse la motivation. Et malgré la charge de travail et les tensions que connaît l’institution, je n’ai jamais été rattrapé par la lassitude. J’ai toujours eu l’impression d’être utile, au cœur de la société.
Comment votre parcours professionnel s'est-il construit ?
J’ai été nommé substitut du procureur à Montpellier. J’y suis resté six ans. Ce premier poste a été fondateur : j’ai aimé ce rapport direct avec la société, cette capacité à agir dans l’immédiateté. Peu à peu, mon parcours a pris forme autour d’un fil rouge : le pénal, sous toutes ses facettes. J’ai été juge d’instruction, toujours à Montpellier. J’ai ensuite intégré la JIRS de Marseille (Juridiction interrégionale spécialisée) à sa création en 2004. C’est un moment charnière dans ma carrière.
Ces juridictions ont été créées pour traiter les formes de délinquance les plus lourdes, les plus structurées : crimes organisés, grande délinquance financière, souvent ce sont des dossiers à dimension internationale. Être à l’origine de cette juridiction, contribuer à sa structuration, était extrêmement stimulant. J’ai aussi eu la chance de créer et d’occuper des postes à l’étranger, comme magistrat de liaison au Sénégal puis en Côte d’Ivoire,
pour faciliter la coopération judiciaire entre la France et plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale. Une expérience concrète et passionnante, qui permet la confrontation avec d’autres cultures, modes de fonctionnement, et nous oblige aussi à l’humilité et à relativiser nos états d’âme et difficultés.
Quelles sont les valeurs qui vous guident ?
L'écoute et l'humanité. Ce sont, selon moi, des qualités essentielles dans notre profession. Il faut savoir entendre, comprendre, expliquer. Simplifier notre jargon autant que possible, être clair, accessible, que ce soit avec les justiciables, les personnels ou les collègues. C'est aussi cela, la dignité de notre fonction.
Un souvenir marquant en 42 ans de carrière ?
Le 13 novembre 2015, j'étais président de la chambre de l'instruction en Guadeloupe. À 6 000 km de Paris, nous avons vécu les attentats en direct. J'ai ressenti un sentiment d'impuissance, de frustration, d'éloignement. J'aurais voulu être à Paris, à la section antiterroriste, pouvoir aider et être utile.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune magistrat ?
Saisissez toutes les occasions de décloisonner votre parcours. Cette profession offre une richesse unique : instruction, parquet, poste à l’étranger, détachements… Ces expériences diversifient le regard, redonnent de l’énergie. Et dans un quotidien parfois confronté à des lourdeurs institutionnelles, ce sont ces ouvertures qui donnent du sens.
Comment percevez-vous l'évolution de votre métier ?
Avec inquiétude. Le droit pénal et la procédure sont devenus d’une technicité extrême, parfois difficilement applicables. Il y a une forme d’insécurité juridique que ressentent les praticiens. Et puis il y a les conditions de travail : sous-effectifs, embouteillages d’audience…
En Guadeloupe comme ailleurs, les cours criminelles sont saturées. La réforme visait à désengorger les cours d’assises, mais les délais sont aujourd’hui très contraints. On juge plus de dossiers de viol qu’il y a 20 ans, mais les moyens ne suivent pas. Il faudra poser sérieusement cette question.
Quel combat vous paraît le plus juste pour l'avenir ?
Travailler sur l'image de la justice. Aujourd'hui, elle ne rassure pas, elle inquiète. Il faudrait mieux expliquer nos décisions, mieux faire comprendre notre rôle. Il y a un vrai chantier autour de la communication judiciaire. C'est aussi un enjeu de démocratie.
Si c'était à refaire ?
Je referai tout. Peut-être avec une incursion à Paris dans l'antiterrorisme, ou même dans un parcours plus diplomatique, mais je n'ai jamais exercé une fonction qui ne m'ait pas passionné.