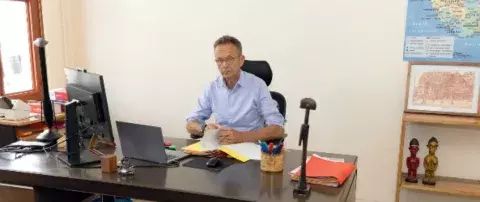[Parole d'expert] Sabine Grégoire, psychologue du travail
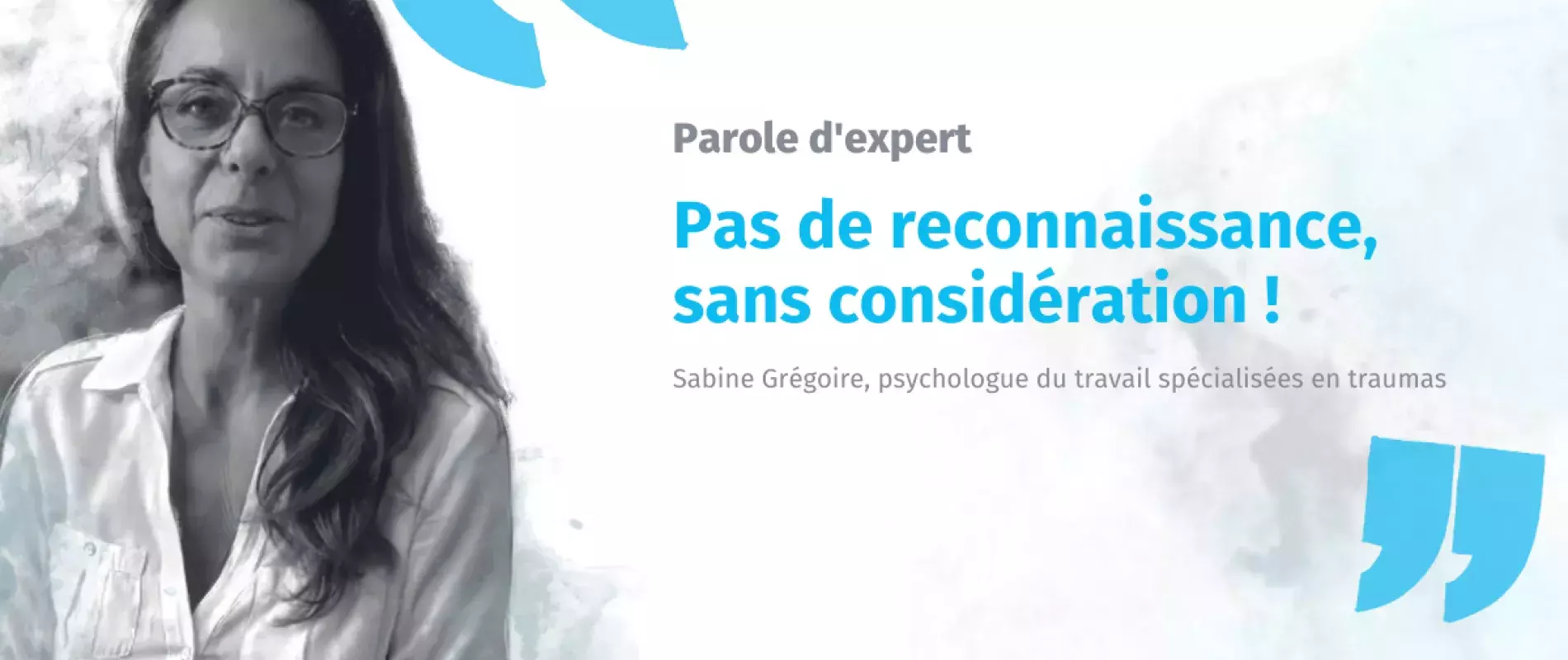
Cette 2e édition du baromètre dessine un portrait des agents du ministère de la Justice tout en souffrance. Que vous inspire ce panorama ?
J’observe que les résultats exprimés ici, qui ne sont pas bons, s’inscrivent dans la continuité de ceux mis en lumière lors de la première enquête. Les agents du ministère de la Justice disent en effet ressentir un fort niveau de stress dans leur activité que la crise pandémique a exacerbé.
Le stress, tel que l’a décrit Hans Selye*, est un syndrome d’adaptation, ou la recherche d’un équilibre entre les exigences et attentes et les ressources et moyens à disposition pour les satisfaire.
Or, le ministère de la Justice a connu ces derniers temps de nombreux effets d’annonce – de #MeToo aux déclarations sur les violences conjugales – qui ont entraîné une forte sollicitation de son personnel, lequel a dû répondre à cette charge de travail supplémentaire sans moyens additionnels.
Si l’on y ajoute la culture du chiffre et du résultat qui prévaut désormais depuis quelques années, il en résulte des effets de stress très importants. À quoi s’ajoutent le manque d’espaces de régulation et d’échanges de pratique, sur fond de télétravail et de digitalisation à outrance, ce qui ne favorise ni l’avancée de dossiers, ni la résolution de problèmes.
Quant au déficit de reconnaissance, il fait référence à la fois au manque de communication avec la hiérarchie et à une incompréhension de l’opinion publique des problématiques propres à ce ministère. Enfin, le rythme de travail n’a cessé de s’accélérer avec des effets pervers liés à
la gestion de la pandémie. Au final, force est de déplorer que ces trois éléments conjugués ont des effets délétères sur les agents.
Quelles sont les mesures immédiates qui devraient être prises par la puissance publique pour améliorer la qualité de vie au travail et plus globalement mettre fin aux nombreuses sources d'insatisfaction rencontrées ?
Aujourd'hui, nous ne parlons plus de QVT mais de QVTC, c'est-à-dire de qualité de vie et des conditions de travail. C'est en octroyant des moyens et des ressources à la hauteur des exigences et des attentes, en interne comme en externe, que le ministère sera en mesure d'améliorer la QVCT.
Au-delà, il est important de former, d'outiller et d'accompagner les managers afin qu'ils exercent leur rôle dans de bonnes conditions. Le management, dont les conditions d'exercice sont particulièrement difficiles, ne s'improvise pas.
En troisième lieu, il faut former tous les agents à l'écoute active et à la communication non violente, les sensibiliser aux comportements délétères et à la prévention du harcèlement. Certes, un certain nombre de mesures ont été décidées et mises en place, mais elles rentent largement insuffisantes.
J'ajoute que la régulation est absolument nécessaire. Il s'agit d'instaurer des temps de supervision avec un tiers professionnel afin de réguler la charge émotionnelle, qui peut être très forte, notamment dans certaines juridictions. Cette régulation peut aussi se concrétiser sous la forme de groupes de parole, de groupes de pairs ou encore de création de réseaux Sentinelles, qui visent à prévenir et détecter les risques psychosociaux.
Autre point essentiel, la considération envers ses collaborateurs. Le but, ce n'est pas que les gens soient heureux au travail - ce n'est qu'une conséquence potentielle - mais bien qu'ils puissent faire correctement leur travail. Sans considération, la reconnaissance peut avoir un véritable effet pervers.
Enfin, il importe d'incarner l'exemplarité. Cela implique d'être juste, d'avoir un comportement adapté et de donner à chacun les moyens de travailler en cohérence. Toutes les mesures que j'évoque ici recoupent la grille Gollac qui classe les facteurs de risques psychosociaux en six grandes dimensions : l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, la dégradation des rapports sociaux au travail, les conflits de valeur et l'insécurité de la situation de travail. Cette grille, qui fait aujourd'hui référence, donne des clés pour détecter et lutter contre ces risques.
Pour conclure, comment voyez-vous la question de la qualité de vie au travail et de la reconnaissance, évoluer à moyen terme ?
Je pense qu'il faut avoir un point de vue systémique de la situation et cesser de confondre causes et conséquences quant à la dégradation de la qualité de vie au travail. Pour assainir la situation, il faut agir à la racine. Il est important de redéfinir les responsabilités de chacun et d'arrêter de cibler le bonheur au travail ou la qualité de vie comme une finalité.
L'enjeu, c'est bien de donner à chacun les moyens de faire bien son travail.
- Depuis plus de 20 ans : psychologue du travail
- Depuis plus de 10 ans : intervient en Fonction Publique d'État et Territoriale
- Depuis toujours : soucieuse de prévenir et non seulement de guérir.